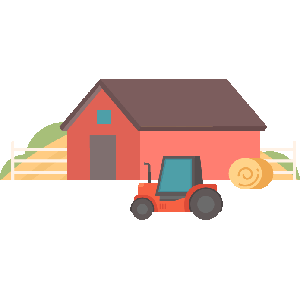Bilan humique des sols et méthanisation
La méthanisation de co-produits agricoles n'a pas à elle seule d'effet sur les stocks de matière organique du sol, tant que le digestat obtenu est épandu sur les parcelles dont les cultures sont récoltées.
L'essentiel
Passer par une opération de méthanisation n'a pas fondamentalement de conséquence ni favorable, ni défavorable sur le bilan humique des sols dans lesquels cette matière organique est introduite. Autrement dit, à long terme épandre de la matière organique brute ou le digestat issu de cette matière organique après méthanisation revient au même du point de vue du bilan humique des sols.
En effet les principaux déterminants de la teneur en matière organique dans les sols sont les stocks de départ, les conditions pédoclimatiques, et les choix des itinéraires techniques susceptibles de favoriser ou non les pratiques "stockantes".
Pour aller plus loin
Différentes comparaisons de scénarios "avec" et "sans" méthanisation ont été réalisées en utilisant des modèles de prévision de stock de carbone à long terme (outil AMG-SIMEOS en France). Elles montrent que les écarts de stockage de carbone à 20 ans à itinéraire technique identique sont peu significatifs, car ils varient entre -0,5 et +0,2 % de la matière organique [Bodilis, 2015].
Des essais menés en Allemagne ont montré que l'utilisation de digestat pendant 25 ans ne présentait pas d'effets généraux sur les indices de fertilité des sols (stock de carbone organique des sols, biomasse microbienne, ratio C/N du sol) [Wentzel, 2015].
A long terme, le flux de matière organique restitué au sol dépend peu du chemin suivi et des différentes opérations successives, il est déterminé essentiellement par la composition initiale des substrats.
La part de carbone retenue dans le sol est similaire si les résidus de fourrages ou effluents (avec digestion animale du fourrage) sont incorporés directement dans le sol ou après traitement par méthanisation, avec environ 12 à 14 % du carbone initial des végétaux [Thomsen, 2013].
Ce sont surtout les effets indirects liés aux évolutions des itinéraires techniques qui peuvent affecter le bilan humique [Møller, 2015]. On peut distinguer des "pratiques stockantes" et des "pratiques déstockantes", certaines pouvant être induites par la méthanisation. Toutes les pratiques "stockantes" ne sont pas nécessairement compatibles entre elles.
L'augmentation ou la diminution des apports de matières organiques stables est le premier facteur de variation du stock de carbone, et ceci indépendamment de leur origine (résidus de cultures, déjections d'élevage, couverts végétaux) et quel que soit le traitement subi (laissé au champ, épandage, méthanisation, compostage).
Pratiques stockantes :
- augmentation de la restitution des matières organiques stables, indépendamment de leur forme, origine ou traitement : résidus de culture, couverts, déjections d'élevage, sous forme brute ou digestat ou compost
- pratique des cultures intermédiaires
- non labour ou TCS (techniques culturales simplifiées)
- agroforesterie
- forts rendements (systèmes racinaires très développés)
Pratiques déstockantes :
- diminution de la restitution des matières organiques stables, indépendamment de leur forme, origine ou traitement : résidus de culture, couverts, déjections d'élevage, sous forme brute ou digestat ou compost
- sols nus en hiver
- labour profond
- absence d'éléments arborés
- faibles rendements (systèmes racinaires peu développés)
Quel seuil minimal de matière organique dans les sols ?
Selon [Loveland, 2003] il est très difficile de parler de seuils satisfaisants, même pour une catégorie de sols donnée. Il ne semble pas exister de seuil en-deça duquel l'état organique du sol serait déficient, et significativement meilleur au-delà. Les fonctions des matières organiques dans les sols dépendent du stock présent, de la nature des matières organiques qui le composent, de leur dynamique et de leur localisation dans le profil du sol.